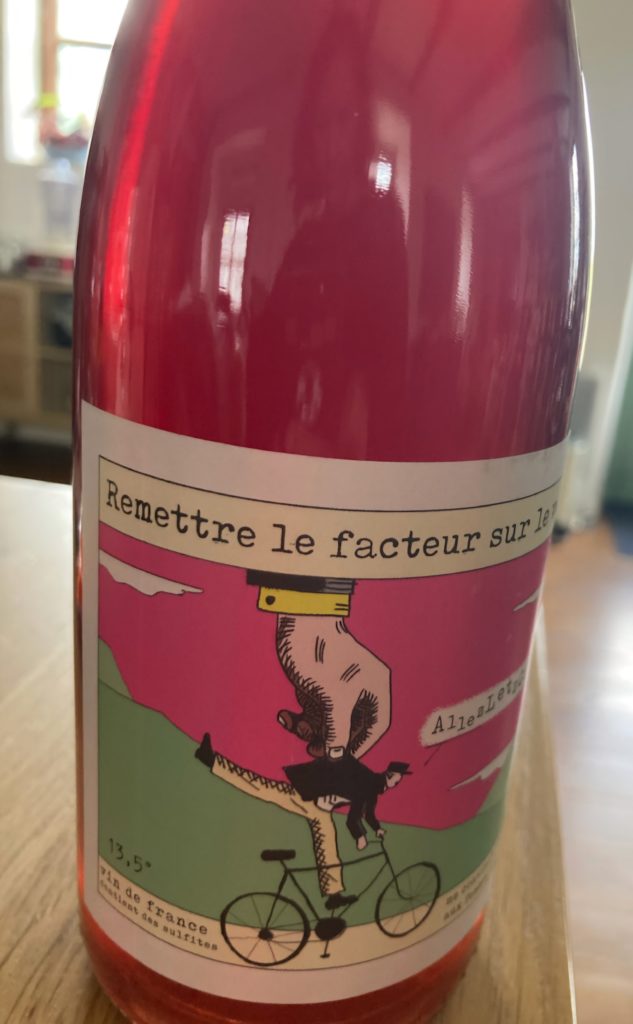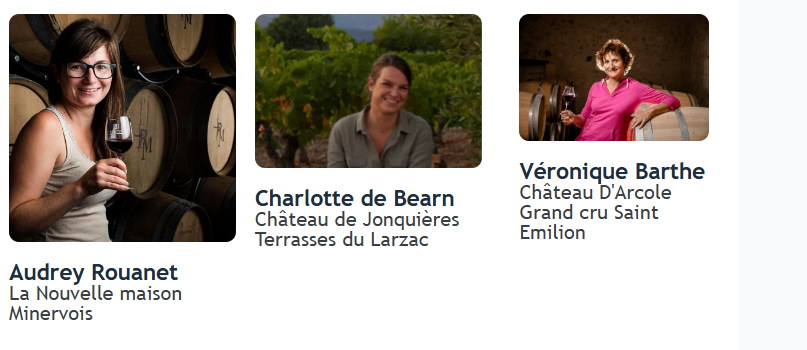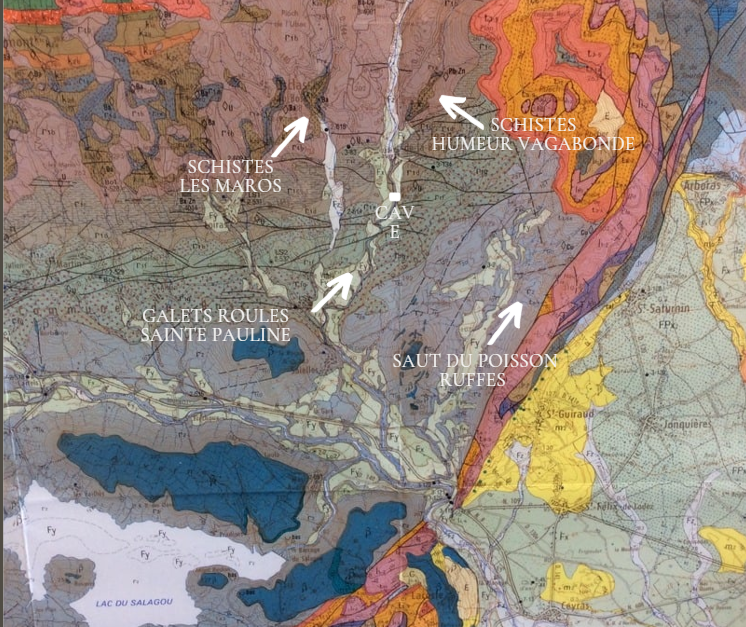Si vous êtes aveyronnais, vous connaissez probablement déjà les Potions d’Oc. Pour les autres, voici une entreprise made in Aveyron bien prometteuse.
À seulement vingt-six ans, Stéphan Marty est un jeune homme que rien ne destinait à partir dans le monde des spiritueux. Calme et sportif, après des études dans l’aéronautique, il se rend compte qu’il a la fibre commerciale, il se réoriente et effectue une licence de commerce. Il se retrouve à travailler à la brasserie de l’Aveyron où il rencontre Thierry Lassauvetat, son gérant. C’est à ses côtés qu’il fait la connaissance de Paul Gayral, propriétaire de la distillerie Gayral. Celui-ci souhaite transmettre son entreprise.
Stephan décide de se lancer, épaulé par son père, Christian Marty, fraîchement retraité, et par Thierry Lassauvetat, lui aussi séduit par le projet.
Pendant plusieurs mois, Paul Gayral les forme et leur transmet tous les secrets de la distillation. Stéphan garde dans la gamme les produits iconiques comme la vieille prune, mais développe sa propre marque.
Aujourd’hui, les Potions d’Oc, c’est une distillerie à Pont de Salars, avec un outil de production simple et opérationnel. Forte d’une vingtaine de produits, des liqueurs, des eaux-de-vie, mais aussi des alcools d’apéritifs. Le jeune homme n’hésite pas à se lancer régulièrement dans de nouvelles créations : « Chaque année, au gré de nos rencontres et de la demande de la clientèle, nous produisons des nouveautés. Tout le monde nous demandait une liqueur de fruits rouges, alors récemment, nous avons décidé de lancer une liqueur de fraise et, dans quelques semaines, suivra une liqueur de framboise ».
Les produits stars de la gamme sont la liqueur de menthe et la liqueur de citron. La gentiane et la liqueur au thé d’Aubrac sont également très populaires, notamment en Aveyron. Mais ce qui fait la grande singularité des Potions d’Oc, c’est leur fabrication artisanale et naturelle. Ici, pas d’arômes de synthèse et des matières premières locales ou limitrophes. « On essaie de trouver des fournisseurs locaux, c’est le cas par exemple du safran, des pommes, mais parfois ce n’est pas possible. La fraise, par exemple, nous avons dû chercher dans le Gard, mais on essaie toujours de rester proche de notre terroir, c’est important ».
Il en résulte une gamme variée avec des produits aromatiques mais frais, sans exubérance, mais chaque produit a sa personnalité. À la dégustation, ce qui m’a plu, c’est le peu de sucrosité des produits. Le sucre maquille tout et, dans les spiritueux de Stéphan, j’ai aimé retrouver le goût des fruits. J’ai évidemment été charmé par la liqueur de safran, d’une grande délicatesse, la toute nouvelle liqueur de fraise a un charme fou et des notes gourmandes de mûre des bois. Dans un tout autre style et en bonne Aveyronnaise, j’ai beaucoup aimé la gentiane et la liqueur au thé d’Aubrac.
Je dois dire que j’ai été impressionné par la cohérence de cette gamme et le professionnalisme de Stéphan qui promet!

.
Stéphan a eu la gentillesse de partager avec nous une recette de cocktail :
- 4 cl de crème de pêche
- 4 cl de liqueur de thé d’Aubrac
- Compléter avec de la limonade et des glaçons et le tour est joué.
(Vous pouvez également ajouter un trait de vodka pour rendre le cocktail un peu plus fou !)
N’hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin d’autres corrections ou ajustements !